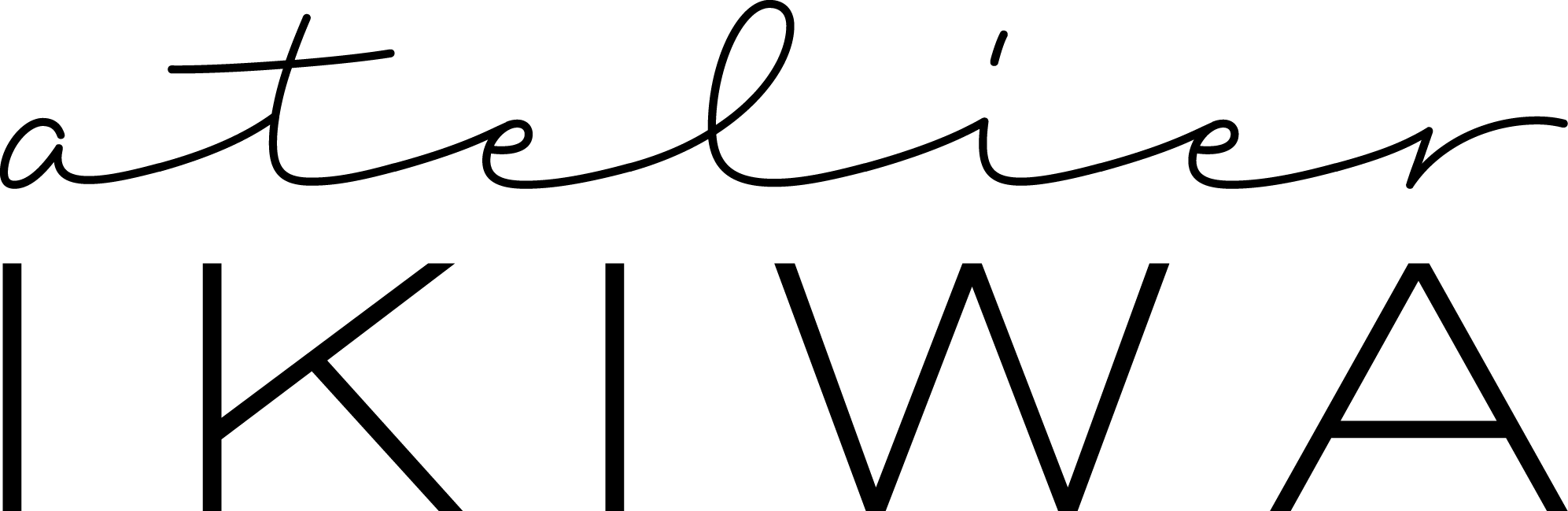Sung-mi Kim et l’héritage cousu main de la Corée
Le fil sensible de Sung-mi Kim
À Séoul, Sung-mi Kim mène depuis plus de quinze ans un travail d’une rare exigence, à la croisée des gestes anciens et d’une sensibilité profondément personnelle. Formée à la menuiserie durant ses études, elle s’est ensuite initiée à la couture au Japon, où elle a vécu trois années avant de revenir en Corée pour étudier auprès d’une professeure spécialisée dans les techniques traditionnelles coréennes.

Son approche n’a rien de systématique : chaque création naît d’une rencontre attentive avec un tissu. Sung-mi arpente les marchés à la recherche de matières oubliées, des trésors généralement filées et tissées par des femmes âgées qui perpétuent des traditions ancestrales, des pièces rares de ramie (mosi), de chanvre et de coton coréens, qu’elle choisit une à une. Elle ne travaille jamais en série. Chaque morceau étoffe, généralement assez petit, appelle une forme, chaque variation de texture ou de couleur ouvre une possibilité. Elle teint elle-même ses tissus, toujours avec des procédés naturels, comme l'encre de calligraphie pour obtenir des gris subtils qui évoquent les montagnes sous la brume, ou d’indigo pour des tonalités bleutées .

Sa couture, entièrement réalisée à la main, s’appuie sur des savoirs anciens, dont elle explore toutes les nuances avec des gestes ancrés dans le contemporain : méthodes d’assemblage invisibles, techniques de matelassage comme le nubi, art exigeant du patchwork pojagi, construction souple sans gabarit figé. Dans ses mains, la tradition n’est ni décorative ni figée. Elle devient un langage souligné par des détails qui n'en sont pas : bordures effilochées pour mieux dévoiler la fibre textile, ajouts de fils contrastés ou de petites broderies qui viennent souligner une couture, d'une infinie poésie. Les pièces de Sung-mi, uniques, se contemplent et font du bien à nos âmes encombrées, elles rappellent le plaisir des choses simplement belles.

Le fil invisible du quotidien
Pendant des siècles, coudre fut un acte aussi banal qu’essentiel dans la vie des femmes coréennes. Il ne s’agissait pas d’un métier, ni même d’un artisanat au sens strict, mais d’une pratique intérieure, invisible, qui structurait le rythme des jours. Dans chaque foyer, les femmes cousaient. Pour créer, mais également pour prolonger : les vêtements, les couvertures, les objets de la maison. Le geste était quotidien, rigoureux, discret. Il s’apprenait très tôt, souvent dès l’enfance, à l’intérieur du gyubang, cet espace réservé aux femmes dans l’architecture traditionnelle coréenne.

La couture formait une part essentielle de l’éducation féminine. On enfilait l’aiguille après s’être lavé les mains, on préparait son espace, on s’asseyait bien droit. Rien n’était laissé au hasard. Le point droit servait de base, mais il existait d’innombrables variations : coutures rabattues, surpiqûres fines, ourlets invisibles. Ce n’était pas l’ornement qui importait, mais la justesse du geste. Une couture réussie se devait d’être régulière, souple, durable. Elle reflétait le sérieux de celle qui l’avait exécutée.

Une vertu féminine dans l’ordre confucéen
Dans la société coréenne traditionnelle, largement façonnée par le confucianisme, chaque individu avait un rôle précis à jouer dans l’équilibre du foyer. Pour les femmes, confinées à l’espace domestique, la couture relevait d’un devoir moral autant que d’un besoin pratique. Elle faisait partie des vertus essentielles : savoir coudre, raccommoder, assembler, signifiait participer activement à la bonne tenue du monde intérieur. L’exactitude du point, la retenue des formes, la sobriété des finitions traduisaient un idéal. Dans les manuels féminins rédigés à la fin de la période Joseon, la couture était présentée comme un art silencieux du soin, de la discrétion et de l’auto-discipline. Une manière de faire, mais surtout une manière d’être.

Des vêtements nés au sein du foyer
La plupart des tenues du quotidien étaient confectionnées à la maison, à partir d’étoffes tissées localement. Le hanbok, dans sa structure même, se prêtait à une couture domestique : il était composé de pièces plates, cousues à angles droits, sans découpes complexes. Les femmes réalisaient des jupes, des vestes, des chemises, des pantalons, des tabliers, des ceintures, mais aussi des sous-vêtements et des chaussettes (beoseon) dont la courbure délicate demandait une grande maîtrise.

Chaque type de vêtement impliquait une attention particulière : les coutures devaient résister au temps, accompagner les mouvements, rester légères sur la peau. Le choix du tissu variait selon les saisons : ramie et chanvre pour l’été, coton pour les intersaisons, ouate pour l’hiver. On cousait à la main, sans machine, avec une grande précision. Le vêtement n’était pas un lieu d’expression, mais un prolongement du corps et de la vie domestique.
Fibres naturelles et teinture végétale
Avant même de coudre, les femmes filaient et tissaient elles-mêmes les fibres végétales. Dans les campagnes, il n’était pas rare qu’une même famille cultive la ramie (mosi), le chanvre ou le coton. Après récolte, les fibres étaient préparées à la main, filées sur un petit rouet, puis tissées sur un métier horizontal. Ce travail demandait patience, savoir-faire, et coordination. Chaque étape, du filage au battage, influençait la texture et la solidité du tissu. Découvrez la rare et précieuse ramie de Hansan, inscrit par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité, dans notre article à lire ici.

Une fois tissé, l’étoffe était lavée, étirée, battue, puis teinte à l’aide de pigments naturels. Le brou de noix donnait un brun doux, les écorces et racines des beiges ou des jaunes discrets, l’indigo des bleus profonds. Ces couleurs, toujours légèrement irrégulières, témoignaient d’une connaissance empirique de la nature, transmise de génération en génération. On choisissait ensuite la coupe en fonction du tombé du tissu, de son épaisseur, de sa souplesse. C’est le textile qui dictait la couture, et non l’inverse.

Objets du quotidien et techniques spécifiques
La couture coréenne ne se limitait pas aux vêtements. Elle s’étendait à l’ensemble des objets nécessaires à la vie domestique. Les femmes réalisaient des sachets pour l’encens ou les herbes médicinales, des housses pour le linge, des sacs pour les graines, des étuis à peigne ou à aiguilles. Chaque objet, même le plus modeste, recevait une attention méticuleuse. Les coutures étaient nettes, solides, sans fioritures. Le geste était toujours mesuré, dans un souci d’économie et d’élégance silencieuse.

Deux techniques emblématiques illustrent cette approche : le nubi, un matelassage cousu à la main, formé de lignes parallèles serrées, utilisé pour les vestes d’hiver, les couvertures ou les protections ; et le bojagi, carré d’assemblage de chutes textiles, utilisé pour envelopper ou couvrir les objets. Le premier requérait une concentration absolue, chaque point devant suivre le précédent avec exactitude. Le second incarnait une forme raffinée du réemploi : rien n’était gaspillé, tout était transformé. Ces deux techniques, aujourd’hui emblématiques, étaient autrefois inséparables du quotidien.

Maîtres couturières et savoirs transmis
Si toutes les femmes cousaient, certaines atteignaient un niveau d’excellence reconnu. On les appelait chimseonjang, maîtres de la couture. Ces femmes, souvent sollicitées pour les tenues cérémonielles ou les habits de la noblesse, maîtrisaient des techniques complexes : coutures dissimulées, finitions parfaites, ajustements invisibles. Leur savoir n’était pas écrit, mais transmis oralement, au fil des gestes. Aujourd’hui, certaines d’entre elles bénéficient du statut de Trésor humain vivant, protégeant ainsi une tradition fragile, qui sans cela aurait pu disparaître.

Des ateliers perpétuent ce savoir à Séoul, Andong ou Naju. On y enseigne encore l’art de tracer un patron sur un tissu vivant, d’assembler sans gaspiller, de prolonger sans forcer. Ces gestes anciens sont désormais considérés comme un patrimoine, non parce qu’ils relèvent du passé, mais parce qu’ils dessinent une autre relation au vêtement et à la matière.

Une mémoire textile toujours vivante
Si la couture n’est plus au cœur de la vie domestique coréenne, ses gestes n’ont pas disparu. Le pojagi connaît un regain d’intérêt dans les milieux du textile contemporain. Le nubi inspire les créateurs sensibles aux notions de lenteur et de durabilité. Certaines femmes continuent à coudre, non pour perpétuer une tradition figée, mais pour maintenir un rapport au tissu fondé sur la retenue, l’attention, la justesse. Sung-mi Kim, par son travail délicat et précieux, tout en étant parfaitement ancré dans une vision contemporaine, perpétue merveilleusement ce riche héritage.
Toutes les photos © Atelier Ikiwa. Elles ont été prises dans l'atelier de Sung-mi à Séoul ♡